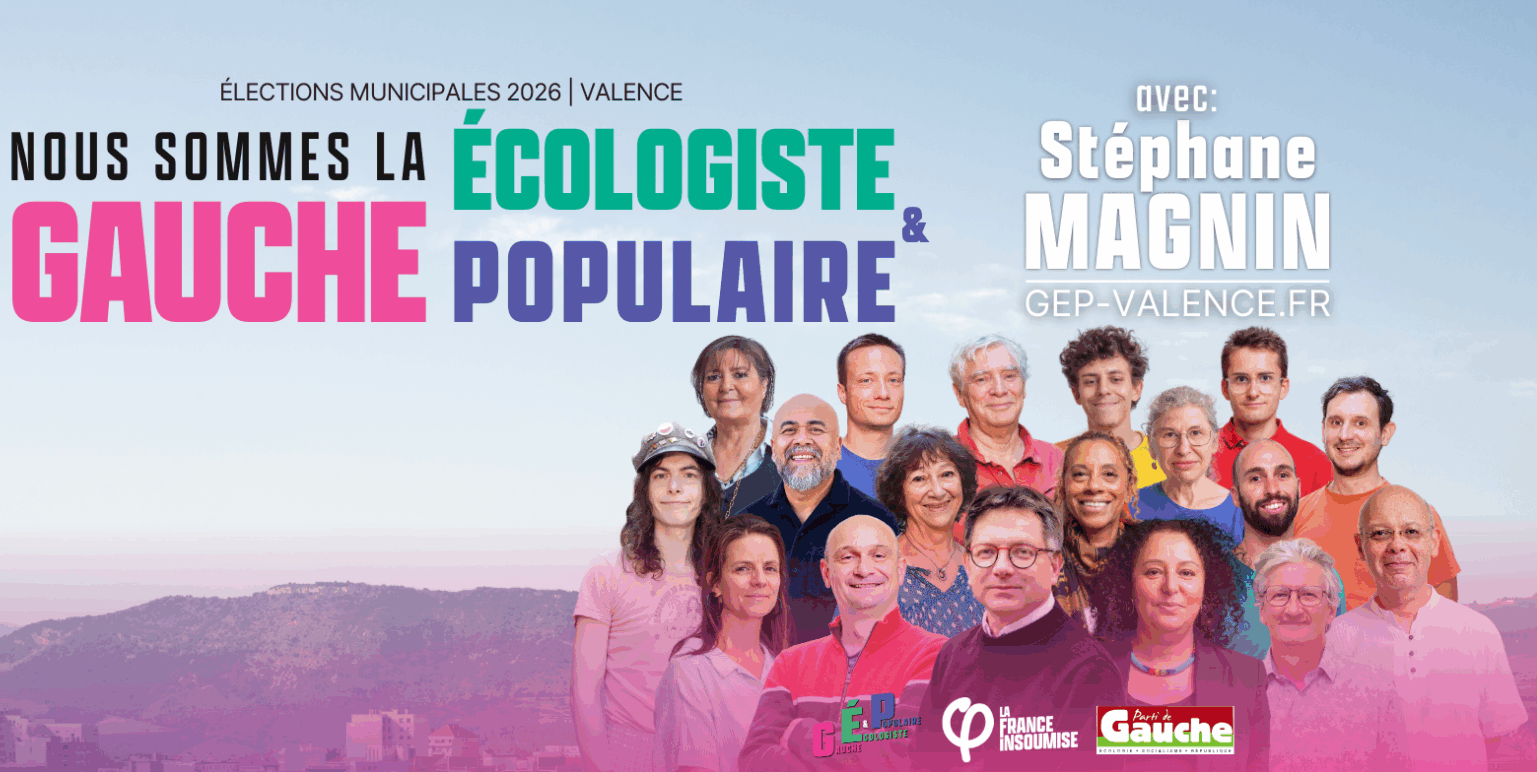…je ne vous fait pas la liste des primaires écolos qui se sont mal terminées» Marine Tondelier – Backseat décembre 2024
Une fois n’est pas coutume c’est par ces mots de Marine Tondelier que je commence mon écrit.. Pourquoi ? Car ces mots font écho aux errances d’EELV à Valence dont les représentants locaux feraient bien d’écouter leur secrétaire nationale plutôt que de se croire plus adroits qu’ils ne le sont.
Les primaires, qu’elles soient organisées au niveau national ou local, sont souvent présentées comme une avancée démocratique majeure. Pourtant, elles constituent une erreur stratégique et structurelle qui affaiblit les organisations politiques politiques et réduit leurs chances de succès électoral. Loin d’être un outil efficace pour désigner des candidats gagnants, elles génèrent des divisions internes, des postures populistes, et une déconnexion avec les attentes des électeurs. De plus, elles sont souvent manipulées par des partis qui cherchent à évincer les candidats légitimes ayant fait le travail, tout en évitant soigneusement d’en organiser là où ils sont en position de force.
1. Un outil d’éviction des candidats légitimes
Dans de nombreux cas, les primaires ne sont pas un processus démocratique sincère, mais un moyen pour certains partis de contourner des personnalités locales ou nationales ayant fait leurs preuves. Ces candidats, qui ont souvent investi des années dans la connaissance des dossiers et le travail de terrain, se retrouvent parfois sacrifiés au profit de figures médiatiques ou de compromis internes dictés par des alliances stratégiques.
Au lieu de valoriser le mérite et l’expérience, les primaires servent alors à imposer des candidats soutenus par des appareils partisans ou des courants influents, souvent au détriment de ceux qui auraient pourtant rassemblé naturellement sur leur bilan. Cette logique dévalorise l’engagement politique de longue durée et envoie un signal négatif aux électeurs, qui perçoivent un manque de sincérité et de cohérence dans le choix des candidats.
2. Une incohérence dans leur mise en œuvre
Fait révélateur, les partis politiques qui défendent les primaires comme une grande avancée démocratique ne les organisent que dans des contextes où ils ne sont pas en position de force. Dans les villes, circonscriptions ou régions qu’ils contrôlent fermement, ces mêmes partis évitent soigneusement les primaires, préférant désigner leurs candidats en interne pour préserver leur avantage stratégique.
Cette incohérence montre que les primaires ne sont pas toujours perçues comme un outil démocratique mais comme une arme politique, utilisée opportunément pour remodeler l’offre électorale dans des zones où le parti est fragilisé ou en concurrence interne. Ce double standard sape encore davantage la légitimité de ce processus et accentue la méfiance des électeurs envers les institutions politiques.
3. Un facteur de division à toutes les échelles
Qu’il s’agisse d’élections présidentielles, législatives ou locales, les primaires plongent les partis dans des logiques de confrontation interne. En opposant des candidats d’une même famille politique, elles provoquent des luttes fratricides qui laissent des cicatrices profondes. Au niveau national, ces divisions fragilisent le candidat désigné en vue de l’élection générale, car il doit non seulement affronter ses adversaires extérieurs, mais aussi surmonter l’hostilité latente des perdants de la primaire.
Au niveau local, le problème est amplifié par la proximité entre les acteurs. Les primaires au sein des circonscriptions ou des collectivités territoriales exacerbent les tensions personnelles et les rivalités historiques. Ces conflits affaiblissent la dynamique de campagne et réduisent la capacité du parti à apparaître comme une force unie aux yeux des électeurs.
4. Une exclusion des classes populaires
L’un des défauts majeurs des primaires est qu’elles excluent largement les classes populaires, qui participent peu à ce type de processus électoral. Cette exclusion tient à plusieurs facteurs :
- La méfiance envers les institutions politiques : Les classes populaires, souvent déçues par les promesses non tenues des responsables politiques, tendent à se désintéresser des mécanismes comme les primaires, perçus comme éloignés de leurs préoccupations concrètes.
- Les contraintes matérielles : Les primaires exigent une disponibilité temporelle (pour voter dans des lieux précis ou à des horaires limités) et, parfois, une contribution financière symbolique. Ces obstacles, bien que modestes, peuvent décourager des électeurs déjà marginalisés.
- Une sur-représentation des classes aisées et militantes : Les participants aux primaires sont souvent issus des catégories socio-professionnelles favorisées, plus politisées et engagées. Ce déséquilibre dans la composition des électeurs fausse le résultat, car les candidats choisis par les primaires reflètent davantage les intérêts de ces groupes que ceux des classes populaires.
5. La négligence de la compétence et de l’expérience
L’un des principaux défauts des primaires réside dans leur incapacité à privilégier des critères essentiels tels que l’expérience, la connaissance des dossiers, et le travail de longue haleine sur le terrain.
Un candidat qui a démontré son engagement sur le long terme, construit des relations de confiance avec les électeurs, et maîtrisé les enjeux de son territoire ou de son domaine d’action est naturellement mieux positionné pour exercer un mandat électif. Pourtant, les primaires tendent à valoriser des qualités plus superficielles comme la capacité à captiver l’attention médiatique ou à répondre à des attentes immédiates.
6. Un frein à la victoire électorale
Que ce soit pour les élections présidentielles ou municipales, les primaires réduisent les chances de victoire des partis en générant des tensions internes et en favorisant des candidats mal positionnés pour séduire une majorité d’électeurs. Ces divisions affaiblissent la dynamique de campagne et donnent un avantage stratégique aux adversaires politiques, qui peuvent se concentrer sur leur propre programme tandis que les partis organisateurs des primaires gèrent les querelles internes.
Les primaires, qu’elles soient nationales ou locales, ne constituent pas une bonne option pour gagner. Leur logique de division interne, leur incohérence stratégique, leur instrumentalisation pour évincer les candidats légitimes et expérimentés, ainsi que leur exclusion des classes populaires, en font une erreur stratégique et démocratique. Repenser les modes de désignation des candidats pour privilégier des profils expérimentés, enracinés dans leur territoire, maîtrisant leurs dossiers, et capables de parler à tous les électeurs, est indispensable pour restaurer la confiance et renforcer les chances de succès électoral.